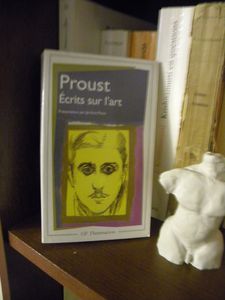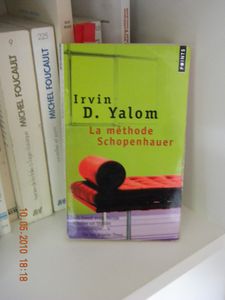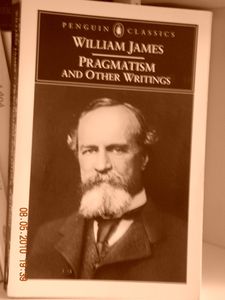L’OPIUM DES PEUPLES

Il y a quelques mois (avant le printemps arabe) le Centre Culturel Arabe (CCA) de Bruxelles faisait un appel d’offre
par l’intermédiaire du Mouvement Anti Utilitariste en Sciences Sociales (MAUSS) pour un colloque ayant trait à l’addiction – L’opium des peuples. Il
était question plus largement de ces dépendances destructrices, meurtrières de culture, de ces processus d’aliénation qui uniformisent et transforment les hommes un peu partout en individus
consommateur. Voici quelques lignes de « l’appel d’offre » évoquant la thématique que le CCA souhaitait que les chercheurs traitassent :
« Les dépendances meurtrières… Cela nous concerne tous
parce que ce monde, cette culture, pourtant pluriels, sont en train de mourir de ces dépendances induites par un système sans pitié dont plus personne ne se sent responsable.
De quoi souffrons-nous ? D’une addiction à la
consommation (culte des « marques », obsession médicamenteuse, nourriture excessive et nuisible, délire sur les objets, etc.), d’une addiction à l’action des media, aux manifestations
des sports de compétition, aux religions. Peu importe, dans ces parties du monde, la fable qui meut et qui restreint les consciences, peu importe que l’on soit juif, chrétien, musulman, ou autre
chose : le résultat attendu, partialité manipulable, violence et résignation en spasmes, est le même.
Un poète arabe de renom, Nizar Qabbani, disait
« Ce n’est plus du sang qui coule dans les veines des Arabes, c’est du coca-cola ».
Perdu entre des positions présentées comme opposées, mais
en vérité, faisant allégeance au même « patron », c’est depuis les « indépendances » nationales que l’irréparable s’accomplit. Fausses
indépendances… »
Après contact avec les organisateurs et vérification de la qualité des autres participants, j’avais décidé de
participer en ma qualité d’intervenant dans le domaine des addictions et de philosophe à ce colloque qui réunissait principalement des sociologues. Mais, une semaine avant l’évènement, la tutelle
du Centre (la mairie de Bruxelles, je crois) refusa de le subventionner. D’après la Directrice jointe au téléphone, une action en justice est lancée devant cette décision qu’elle juge arbitraire,
méprisante et aux relents purement racistes. Je ne connais ni les tenants et aboutissants éventuellement cachés de cette décision, ni l’historique du Centre, et je ne peux donc me prononcer sur
la teneur de cet évènement. Je dois dire cependant que la liste des invités ne laissait pas supposer un dangereux rendez-vous d’extrémistes, ni même de militants, mais tout simplement de
chercheurs.
Quoi qu’il en soit, voici – un peu remanié pour les besoins du blog - le texte de mon intervention, si elle doit avoir
lieu un jour.

Introduction
Je distinguerai d’abord entre l’idée de consommation de substance psycho actives, dans un
cadre traditionnel, rituel et religieux, d’une part, et la problématique contemporaine de l’addiction, d’autre part, en passant pour cela par une analyse socio historique et philosophique qui met
en avant la question de l’individualisme et les effets du capitalisme sur ce phénomène.
Ensuite, j’essaierai de voir dans quelle mesure ces mécanismes sociologiques liés aux
phénomènes d’addiction ont une effectivité dans la sphère non occidentale. Dans cet ordre d'idées, je mettrai en lien l'addiction d'une façon générale et les effets de déconnection du réel – la
production d'une hyper réalité - induits par l'hyper civilisation américaine.
A contrario de la thèse d’un supposé choc de civilisations qui seraient par essence trop
différentes, la problématique des addictions et de leur expansion mondiale indique sans doute une sorte d’homogénéisation – des convergences génératrices d’indifférenciation, mais qui sont aussi
par là même source de violences, de rivalités, de frustrations et de « mauvaise » émulation concernant les objets de consommation.
J’essaierai cependant, avec la thématique des réseaux fraternels et des groupes d’entraide,
de mettre en valeur des alternatives à cette homogénéisation violente, source d’une addiction au quantitatif du « toujours plus ». Ainsi, la notion de fraternité permet de faire
référence à ce qui constitue le noyau de notre humanité commune au-delà des différences périphériques (sociales, ethniques, religieuse) dans des situations souvent caractérisées par le danger, le
risque, la crainte de la catastrophe, ou même le manque.
Enfin, je m’appuierai sur mon expérience dans le champ du soin des addictions pour montrer
comment on peut opposer au zapping pulsionnel de la consommation culturelle une transmission de l’art vecteur d’un désir plus authentique, source de subjectivation et de recomposition de
l’humain.

I - DISSOLUTION
DU LIEN SOCIAL HOLISTIQUE
A- La consommation des substances psycho actives
L’usage de ce qu’on appelle des substances psychotropes est une constante universelle. Les
études archéologiques permettent de faire remonter très loin dans le passé le recours à des substances susceptibles de modifications comportementales ou de la perception.
La dimension sacrée liée aux drogues est évidente dans la mesure où la substance est
considérée comme ce qui permet d’ouvrir les portes de perceptions extra sensorielles, d’être en lien avec le divin, ou encore comme un accessoire essentiel de rituel ou d’oblation. Ainsi, chez le
peuple Huichol, absorber le cactus Peyotl (d’où proviendra la mescaline) revient à absorber la chair des dieux, à communiquer symboliquement avec la divinité. Idem pour les indiens : dans
les Védas, les textes les plus anciens de l’Inde, on parle du rituel du soma, dont il est peut douteux qu’il s’agisse du chanvre. D’autres textes mentionnent le bangh qui est un hallucinogène
toujours employé lors de cérémonies rituelles en Inde. D’ailleurs, on fume le shilum en Inde en invoquant Shiva. On le sait, les drogues sont aussi clairement associées aux pratiques chamaniques.
De même, le vin est associé depuis longtemps à Dionysos, symbole de vie et de renaissance, sans parler de la symbolique du vin dans le christianisme.
En termes de causalité, sans doute peut-on faire remonter ce type de phénomènes à un
problème fondamental de l’existence humaine : ces pratiques, parmi d'autres, feraient ainsi partie de l'arsenal visant à surmonter le traumatisme originaire de la séparation, le sentiment
d’incomplétude, de solitude sous-jacent en chacun de nous. L’existence est caractérisée par une détresse initiale liée au sentiment de notre séparation avec un tout originaire – sur le modèle de
la séparation du bébé avec sa mère – et qui nourrit toutes les mythologies humaines (du Banquet de Platon au jardin d’Eden, etc.). Le besoin le plus
essentiel de l’homme serait donc de surmonter cette séparation avec l’angoisse qu’elle génère. Les drogues seraient une réponse partielle à cette détresse initiale.
L’usage est donc une constante dans l’histoire. Simplement, on peut constater que depuis
les premiers contacts avec les « plantes magiques » jusqu’aux contextes actuels de consommation et de surconsommation, les usages se sont lentement transformés : contextes sacrés,
médicinaux, guerriers, conviviaux, hédonistes, stimulants de la performance, auto thérapeutiques ; tout cela se succède ou se côtoie.
Sans y être complètement étrangère, l’addiction relève bien sûr d’une autre problématique
que celle liée au contexte sacré, et elle se situe plutôt du côté de l’auto thérapie. En même temps, elle aussi constitue bien souvent une sorte de réponse à un vide existentiel, à une angoisse
fondamentale.
On évitera les distinctions supposées subtiles entre addiction et dépendance ; pour
aller vite, nous définirons sa manifestation comme le besoin impératif, la nécessité pour un individu de consommer un produit, ou d’adopter un comportement quelconque, malgré sa connaissance des
conséquences négatives ultérieures de cette consommation ou de ce comportement, pour lui-même et son entourage. Cet aspect souvent soudain et impératif est aussi appelé compulsion, ou encore
« graving ».
Dans les milieux du soin, on s’accorde à penser toutefois que ce problème précis
d’addiction ne touche finalement qu’une minorité d’individus, pour des raisons de fragilité personnelle liée à des conditions familiales, psychologiques, génétiques qui se combinent elles-mêmes
avec des facteurs sociologiques. C’est la fameuse rencontre d’un produit, d’un individu et d’un contexte socio culturel.
B – Egalisation des conditions et individualisme
Dès lors, pour mieux comprendre la problématique de l’addiction proprement dite, et surtout
la raison pour laquelle certaines fragilités se manifestent aujourd’hui sous cette forme, il convient à mon sens de prendre en compte l’impact de l’individualisme moderne. Nous le savons depuis
Tocqueville – incontournable sur ce point -, cette caractéristique sociologique moderne (qu’il ne faut pas confondre avec la catégorie morale de l’égoïsme) est liée de façon consubstantielle à un
mouvement de fond inéluctable, la démocratisation, comprise, non comme une forme particulière de gouvernement, mais comme « égalisation progressive et croissante des conditions ». Ce
mouvement de nivellement des strates sociales de l’aristocratie – que l’on appelle la dissolution de la structure holiste –, entraîne corrélativement une dissolution des solidarités attachées à
cette ancienne structure hiérarchique de la société, dans laquelle prévalaient devoirs et obligations de castes. C’est sur ce fond de déstructuration que l’on assiste à une atomisation des
individus et à une émergence de l’individualisme. Comme l’écrit Tocqueville (1986) :
« L’aristocratie avait construit une longue chaîne du paysan au Roi, la
démocratie brise la chaîne et met chaque maillon à part ».
Dans ce mouvement, tous les rapports entre les hommes se trouvent bouleversés. Du fait de
cette démocratisation, ils ne sont plus assignés de toute éternité à une place immuable qui trace leur destinée et circonscrit leur identité ; ils peuvent évoluer, changer de condition,
poursuivre un bonheur individuel, faire fortune, la perdre, etc. Selon l’exemple de Tocqueville lui-même, le fait d’être serviteur n’est plus qu’un contrat temporaire, qui n’engage plus corps et
âme, et qui ne donne plus tous les droits au maître. Dès lors, les hommes vont moins s’identifier par leur place ou leur fonction dans la structure sociale que par leur intériorité, leurs désirs,
et leur personnalité cherchant à se faire reconnaître dans une quête toujours plus profonde d’authenticité. Au terme de ce bouleversement très important, l’individu est devenu le nouveau critère
de référence sociologique.
L’aristocratie était donc un système solidaire. Il peut sembler bien sûr étrange, voire
scandaleux, pour nous modernes, d’évoquer une notion comme la « solidarité » au sujet d’un système où régnaient des formes de domination aussi terribles que le servage. En ce sens,
l’émergence de l’individualisme ne peut être bien sûr présentée uniquement sous les sombres auspices d’une déstructuration, et nous ne pouvons que nous féliciter d’une évolution correspondant à
un mouvement d’émancipation vis-à-vis de ces tyrannies des temps aristocratiques. D’ailleurs, comme le montre A. Ehrenberg, on ne peut parler vraiment de dissolution du lien social ;
l’individualisme contemporain qui met l’individu au centre du jeu est tout simplement une autre manière de faire société, avec un certain nombre d’inconvénients, mais aussi des avantages, comme
une possible attention plus affirmée à la personnalité de chaque homme, avec ses caractéristiques singulières.
Reste qu’il s’agissait d’un système holiste caractérisé en premier lieu par un lien
d’interdépendance, et donc d’un système structurant malgré tout. Quoi qu’en disent A. Ehrenberg et ceux qui critiquent la pertinence opératoire de l’analyse de Tocqueville pour notre
(post)modernité, la modification essentielle de l’ordre social que constitue la rupture de ce lien holistique entraîne corrélativement des bouleversements anthropologiques - situation qui ne
laisse d’interroger l’époque contemporaine à bien des égards. Citons, dans le désordre, quelques uns de ses effets - que l’on s’en félicite ou non par ailleurs :
- le déclin de l’autorité, y compris, aujourd’hui, dans
les sphères familiale et scolaire ; on parle aussi en psychanalyse de déclin de la référence paternelle ; ce qui tend d’ailleurs à rendre la psy nécessaire ;
- des formes nouvelles, plus douces et plus subtiles de
domination de masse (système médiatique, marketing) après les totalitarismes du 20ème siècle ;
- la dissolution des solidarités de
classes ;
- le déclin des « grands récits » dans notre ère
post moderne, et corrélativement du parti communiste qui contribuait à structurer la classe ouvrière ;
- la solitude paradoxale de l’individu dans les
grandes villes ; le malaise (d’ordre dépressif) inhérent à « la fatigue d’être soi » (pour reprendre le titre du livre de A. Ehrenberg) dans un monde où l’identité n’est plus uniquement
assignée par la fonction dans l’ordre social ; il « faut » s’accomplir, se réaliser, jouir à tout prix sous peine d’anormalité ; on a pu parler (Lacan) d’ « impératif
surmoïque de la jouissance » ;
- le déclin
des transcendances, la perte tendancielle du sens du sacré qui entraîne de façon inversement proportionnelle des mouvements d’adhésion des plus fragiles, ou des plus avides de spiritualité, dans
des sectes - comme l’avaient très bien prévu Tocqueville ou Adam Smith.
- A mon sens, il va également de soi que ce mouvement
général n’est pas étranger à l’explosion des conduites addictives.
La problématique de la dissolution du lien social holistique permet en quelque sorte de
subsumer sous l’unité d’un concept ce mouvement, avec tous ses éléments qui peuvent sembler à première vue quelque peu hétérogènes.
Reste, bien sûr, que tous les individus ne développeront pas des addictions à des produits
– seulement en fonction de caractéristiques qui leur sont propres.
Mais il faut aller plus loin ; ce mouvement de fond de l’individualisme, que personne
ne maîtrise, et que Tocqueville présentait comme « providentiel », c'est-à-dire inexplicable et sans cause humaine assignable, ne suffit pas à expliquer la logique de l’addiction, ni
même les détresses sociales et humaines spécifiques de notre modernité. A cet égard, A. Ehrenberg a raison ; il faut prendre en compte aussi des interventions humaines, socio politiques plus
repérables et précises qui encouragent cette tendance.

C – La transformation de l’individu en consommateur
1 – La perspective foucaldienne
C’est un lieu commun de constater aujourd’hui que nous sommes dans un monde régi par un
ensemble de principes libéraux – au sens économique du terme - tendant à envahir toutes les sphères, et en premier lieu celle de l’Etat moderne. On a
pu ainsi parler récemment d’un démantèlement de l’Etat qui repose sur la logique du marketing. Et cela touche les individus, bien sûr, puisque cette logique consiste à inciter les individus à
changer de comportements, à intégrer la logique de la performance, à devenir des individus consommateurs.
En ce sens, le capitalisme touche à ce qui définit l’existence humaine. L’homme étant cet
être très particulier qui ne peut se contenter d’être là à la manière des choses et des animaux, ce projet qui a toujours à être, à dépasser l’être là de sa condition pour exister, la grande
performance du capitalisme – ou son grand dévoiement - aura été d’intégrer cette exigence, de l’assimiler (comme toute chose) à son propre avantage, pour son développement propre. Il aura ainsi
réussi à transformer la nécessité de dépassement de soi qui caractérise ou définit essentiellement l’existence humaine, en processus de production,
de consommation et d’accumulation exponentiel.
Or, il ne va pas de soit qu’on puisse ici parler de mécanisme providentiel, comme c’était
le cas avec Tocqueville. De fait, tout cela n’est pas arrivé par hasard, n’est pas tombé du ciel : quant à ce processus, il existe des dates et des étapes. A ce sujet, il serait tentant de
globaliser, et d’assigner donc simplement la responsabilité de ces phénomènes d’addiction, de détresse et de solitude au libéralisme. Mais il faut justement être ici plus précis, et évoquer le
néo libéralisme, lequel, contrairement à certaines idées communes, ne peut être compris comme un simple prolongement, une excroissance monstrueuse de la doctrine libérale classique du laisser
faire telle qu’on la connaît depuis le 18ème siècle (A. Smith). Au contraire, une césure apparaît dans son histoire : ainsi Foucault montre qu'afin de refonder le libéralisme dans
la première partie du 20ème siècle un véritable interventionnisme de l’Etat se met en place consistant à rompre avec la doctrine libérale du laisser faire – jugée inefficace dans les
années 30, suite à la crise de 29. Foucault (dans ses Cours du Collège de France – Sécurité, territoires et
populations) décrit la façon dont en 1938 au colloque de Paris, un certains nombre de libéraux célèbres s’efforcent de définir des nouveaux principes politico économiques afin de faire en
sorte que l’Etat intègre les règles juridiques du droit marchand. On peut parler d’interventionnisme libéral.
Ensuite, en 1947 en RFA, l’Etat allemand cherche à se refonder ; mais, pour conjurer
les vieux démons du fascisme, cette refondation ne sera tolérée par les forces d’occupation qu’à la condition que cet Etat encourage les libertés, comprise concrètement comme libéralisation des
prix. Dès lors, on fait de la concurrence un devoir, une norme inscrite dans la constitution. Il faut donc comprendre aussi, si on se fait l’avocat du diable, que transformer l’individu en
consommateur – quels qu’en soit les effets pervers – est toujours préférable à l’individu guerrier.
Le grand saut est enfin accompli dans les années 79 – 80 avec Reagan et Thatcher. Le
consensus de Washington instaure une nouvelle norme mondiale, la concurrence généralisée entre Etats, sociétés, firmes, etc., ce qui n’est évidemment pas sans impact sur les hommes. Les individus
sont appelés à devenir « les entrepreneurs d’eux-mêmes ». Les Etats prennent l’initiative de libéraliser le système bancaire. On insiste sur la notion de citoyen consommateur, qui a
intérêt à la concurrence.
Aujourd’hui, il s’agit donc de réformer l’Etat afin qu’il intériorise le droit privé ;
on parle d’individu et d’Etat entrepreneurial ; logique qui s’étend à tous les domaines, et notamment le social (marché de l’aide à la personne, démarche qualité, évaluation quantitative –
il s’agit moins d’évaluer réellement que d’inciter les acteurs à intérioriser cette logique). Il s’agit d’obtenir, par transformation de l’Etat, le transfert de la logique de marché, hors marché.
Ainsi est vidée de son sens la notion de service public. Cette transformation vise aussi et en priorité l’individu. On cherche à remodeler le sujet, à conquérir son intériorité. Par des
mécanismes de peur (chômage) est ainsi produit un individu qui intériorise ces normes, en auto évaluation permanente, comptable de tous ses actes.
2 – B. Steigler et les mécanismes du marketing
Il existe aussi des mécanismes subtiles et plus complexes, permettant de comprendre cette
métamorphose, ce que signifie cette transformation de l’individu, et comment elle s’est opérée, concrètement et historiquement. Il faut faire ici référence à une théorie américaine du marketing
qui commence à avoir une consistance historique ; pour elle, l’essentiel est désormais de contrôler des acheteurs et non pas des marchandises. Aujourd’hui, les marchandises sont de toute
façon fournies à faible coût par des pays comme ceux du sud-est asiatique. Dans des recherches très poussées auxquelles je renvoie, B. Steigler montre bien les processus et les techniques - la
télévision depuis longtemps, et maintenant Internet, bientôt les nanotechnologies – par lesquelles cette transformation opère, bien souvent euphémisée sous le vocable de « fidélisation du
consommateur ». Il montre notamment comment on s’efforce de fixer l’énergie libidinale, comment on détourne l’attention que l’enfant consacre à ses parents, ou même aux objets secondaires
susceptibles de sublimation, en dirigeant son identification primaire sur des artéfacts, télévisuels ou autres, contrôlés par les industries culturelles, plutôt que les
parents.
Tout cela a aussi une histoire assez précise. Sans entrer dans le détail, à partir du début
du XXe siècle, les Etats-Unis en particulier, vont inventer des techniques de contrôle du comportement des individus, pour leur faire adopter des comportements de consommation. Et cela avec
l’aide d’Edouard Baynes, neveu de Sigmund Freud, véritable fondateur du marketing, qui va s’appuyer sur les mécanismes inconscients du désir afin
de canaliser les désirs des consommateurs et de les soumettre à l’objet industriel. On comprend très bien dès lors comment peuvent se mettre en place ce que l’on appelle des injonctions
paradoxales : « que faire quand la ville toute entière devient dealer ?», demande la philosophe Cynthia Fleury. De fait, l’addiction est l’envers du système généralisé. Avec les
injonctions paradoxales du système on pourrait parler d’un ajournement permanent d’avoir à devenir adulte, ajournement qu’il favorise. Il existe en effet une servitude volontaire de l’addiction
permettant d’éviter l’angoisse du devenir sujet. Et cela dans la mesure où, à des fins de standardisation du désir, le système engendre progressivement un détournement de l’énergie libidinale de
ses objets spontanés, mais aussi et surtout de ces objets indirects et secondaires que sont les objets sociaux, les objets de ce que l’on appelle la sublimation, ceux qui entraînent des processus
de subjectivation.

3 – Addiction générale
D’une certaine façon, les addicts aux substances traditionnelles ne sont jamais que des
excroissances quelque peu caricaturales d’une addiction plus générale à laquelle nous succombons tous.
Comme le montre Isabelle Sorente, on pourrait dire que le mal dont nous souffrons tous est l’addiction au
calcul, aux chiffres, à une saisie mathématique exponentielle de tous les domaines de la vie – qu’il s’agisse de notre poids sur la balance, d’un compte en banque, de la surface d’un appartement,
du taux de fréquentation d’un blog, etc. La liste des mécanismes addictifs au calcul est ainsi quasi infinie ; en galiléo cartésiens fous et hyperboliques, nous tendons à traduire chaque
chose en langage mathématique ; ce qui ne serait pas un drame en soi si cette tendance purement productiviste ne modifiait notre rapport à la corporéité du monde, ne réduisait par là même
notre humanité, notre sensibilité et notre faculté de raisonner.
De même que les autres substances addictives, mais de façon plus sournoise parce que les chiffres qui
régentent nos vie sont souvent impalpables et que le processus est indolore dans ses prémisses, le calcul fait de nous des addicts, avec les conséquences que cela peut entraîner dans notre
rapport au monde, à nous-mêmes et aux autres. Ainsi, comme tout addict, le calculateur se ferme au réel pour poursuivre un rêve de maîtrise absolue, réfractaire à toute
incertitude.
Comme chez tout addict obsédé par la quête exclusive et infinie de son produit de choix, notre champ de
perception et notre sphère d’intérêt se réduisent en proportion, petit à petit. Ultimement, nous nous enfermons de façon égocentrique dans notre propre monde, un monde de représentations,
parallèle à une réalité qui, elle, tend à disparaître (comme l’ont bien vu chacun à leur manière des penseurs aussi divers que Debord, Baudrillard ou Muray)
En quoi cela concerne-t-il les pays Arabes, ses
immigrations, et sa culture ?

II – LE DESIR MIMETIQUE
A – Le dépassement de la sphère occidentale
De fait, il semble évident que le phénomène décrit plus haut dépasse la sphère occidentale.
C‘est le cas en Inde, par exemple. En un sens le mouvement progressif de dissolution des castes, c'est-à-dire d’égalisation croissante des conditions et la montée d’un certain individualisme, est
aussi à l’œuvre en Inde ; et il est contemporain de l’entrée de l’Inde dans la mondialisation en 92. Disons que cette entrée officielle a constitué un formidable accélérateur de ce mouvement
dans la mesure où, là aussi, on assiste à l’émergence d’une classe moyenne avide de produits de consommation.
Mais, comme rien n’est simple, de récentes études tendent à indiquer que le reflux de la
notion de caste, le rejet de cette catégorie comme entité pertinente, ne joue pas nécessairement dans le sens d’une démocratisation réelle - dans la mesure où l’on prend désormais moins en compte
l’appartenance à une secte défavorisée pour mettre en place des processus de ségrégation positive, comme par le passé.
J’en viens au printemps arabe ; il en existe bien sûr une version optimiste – disons
une version kantienne de l’universalité démocratique. L’idée féconde de la Philosophie des Lumières selon laquelle elle constitue un horizon universel. Pour Kant, il n’y aurait ainsi
d’incompatibilité de la démocratie avec aucune culture. On ne pourrait certes que s'en féliciter – la suite dira elle-même sa vérité, même si l’on sait que cela prendra du
temps.
En même temps, le versant pessimiste concernant ce mouvement d'accélération générale peut
être illustré par ces mots du poète arabe : « Ce n’est
plus du sang qui coule dans les veines des Arabes, c’est du coca-cola ».
Dans un livre à paraître qui compare la civilisation américaine et la culture chinoise, le
philosophe Thorsten Botz Borstein opère une rigoureuse et très éclairante distinction conceptuelle entre la civilisation et la culture où il en arrive à démontrer que l'hyper civilisation
américaine (et son absence de culture), d'une part, et l'excès de culture chinois (et son absence de processus de civilisation) d'autre part,
contribuent tous deux à la production de deux mondes déconnectés du réel, deux hyper réalités sans véritable lien (et donc, à un dialogue de sourd, avec tous les dangers que cela peut entraîner).
Il s'appuie pour cette démonstration sur Deleuze pour montrer comment cette occupation rhizomatique de l'espace contribue à entraîner dans son sillage d'autres territoires, et sur le Baudrillard
d'Amérique (auquel j'adjoindrais personnellement les considérations post historiques de Muray sur la société hyper festive). Je n'ai pas suffisamment
de compétences en matière de civilisation/culture arabe, et j'ignore dans quelle mesure ce type de distinctions serait ici adéquat ou pertinent. Quoi qu'il en soit, son analyse de l'hyper
civilisation américaine et de ses effets est à mon avis éclairante pour notre propos concernant la perte de la réalité, de la raison et des sentiments propice à une addiction
généralisée.
En effet, Murray ou Baudrillard nous décrivent une civilisation d’après l’histoire,
déréalisée, sans vie, hyper festive, qui rejette ou pourchasse toute négativité : le grand parc de loisir généralisé. La civilisation Disney « intègrera le monde entier dans son univers
synthétique, sous la forme d’un vaste « spectacle de la réalité » où la réalité elle-même devient spectacle, où le réel devient un parc à thème ». Baudrillard évoque la vision d’un
monde disneyifié, comme une sorte de « centre commercial global » ne comportant pas nécessairement les caractéristiques matérielles de l’architecture Disney, - mais disneyifié au sens
où simplement le monde lui-même (ou des parties de ce monde) serait transformé en « reality show » organisé par quelques personnes puissantes, et dans lequel les habitants adopteraient
le rôle de figurants. L’intégration d’environnements existant dans la civilisation Disney, ce serait cela le nouvel impérialisme, et la nouvelle servitude volontaire. « La Californie
elle-même en vient à ressembler à une gigantesque agglomération de parcs à thème, un lieu de vie des mondes de Disney. C’est un royaume constitué de différentes vitrines de la culture du village
global et des paysages mimétiques américains, et qui est empli d’étranges pastiches ». Un monde hyper civilisé, sans négativité, en quelque sorte.
La théorie complète de Baudrillard de la première Guerre du Golf comme un événement qui
« n’a jamais eu lieu » doit être comprise comme l’intégration d’environnements culturels existants dans la civilisation Disney. Bien que la Guerre du Golf fût définitivement réelle, l’expérience médiatisée de la guerre semble en avoir pris la place, indépendamment de l’événement lui-même.
La négativité et sa violence, c’est l’histoire. Dans notre monde disneyifié, des hommes comme Saddam Hussein ou Kadhafi, avec leur violence, leurs contradictions,
etc. apparaissent comme les derniers spécimens d’hommes de la négativité, d’avant la fin de l’histoire. Mais, ce ne sont plus en fait que des bouffons amusant la galerie médiatique, et qui n'ont
pas compris que l'histoire est terminée depuis longtemps. Bienvenus,
peuples arabes, dans le "désert du réel" ! Entrez ici dans la société hyper festive, dans le grand centre commercial généralisé ! Jouez votre partition au coeur du vaste parc de loisir où l'on
attend de vous que vous deveniez les bons figurants mimétiques d'une réalité qui, de toute façon, n'existe plus ! Et surtout, n'oubliez pas de consommer !!
B - Le mécanisme girardien
Ce processus d'homogénéisation global n'est bien sûr pas sans toute sorte d'impacts et de
conséquences sur les rapports entre les hommes et entre les peuples. A cet égard, bien que très éloignée de l’analyse sociologique précédente relative aux métamorphoses du capitalisme (ou même
des analyses de Baudrillard), la référence anthropologique à la théorie girardienne du désir et de la rivalité mimétiques fournit une grille de lecture intéressante, qui permet peut-être de
rendre compte aussi de la montée de ce phénomène d’addiction à la consommation dans les cultures et pays non occidentaux.
René Girard nous annonce que le désir a une structure triangulaire ; autrement dit
qu’il s’enracine ni dans l’objet, ni dans le sujet, mais dans le modèle, c'est-à-dire, virtuellement, le rival. Contrairement aux illusions (romantiques) que nous pouvons éventuellement
entretenir, une fois qu’est dépassée la sphère des besoins primaires, notre désir ne se porte jamais directement sur un objet. Notre désir se porte vers ce qui nous est désigné par le désir d’un
modèle, lequel risque toujours à terme de devenir un rival.
L’objet est recherché au départ, mais il tend à disparaître au profit de l’être du modèle,
qui est le plus enviable. Là aussi, les spécialistes du marketing ayant bien mieux compris les choses que les psychanalystes ou autres philosophes, pour comprendre ce point, on peut penser à ces
publicités dans lesquelles on cherche à éveiller le désir d’un objet par la médiation d’un modèle – une star du sport, du grand écran, une pin up –
qui est censée désirer cet objet. Fondamentalement, c’est l’être du modèle que nous désirons. On peut aussi, concernant la rivalité, se représenter des haines existant entre rivaux ; il
suffit de songer à des hommes rivalisant pour un poste, ou pour une femme, pendant des années. Le poste ou la femme en question tendra à devenir secondaire, voire à disparaître, au regard de la
rivalité, des questions de prestige et de préséance, de la haine, d’une habitude, ou même d’une certaine affection entre les rivaux - bref de la nature de la relation qui s’instaure entre
eux.
« Plus le modèle se transforme en obstacle,
plus le désir tend à transformer les obstacles en modèles ».
Tout est possible ; le triangle peut en effet s’inverser, l’imitateur devenir un
imité, le maître devient esclave et imite l’esclave (c’est la médiation double), l’objet un sujet, etc. Quoi qu’il en soit, le désir, de façon nécessaire, risque toujours d’entraîner la
discorde. Ce schéma de la rivalité des désirs est sans doute encore plus vrai à mesure que ce rival – le médiateur, comme l’appelle R. Girard – se
rapproche de nous, qu’il devient un médiateur interne, tendanciellement notre égal ; comme c’est le cas dans nos sociétés démocratiques caractérisées par la perte des transcendances, par une
égalisation croissante des conditions, bien décrite par Tocqueville. Dès lors que les hommes sont tous par nature plus ou moins égaux, ils n’imitent plus un être inaccessible (Dieu ou un héros
lointain, ou d’une caste supérieure) et tendent à rivaliser pour les mêmes objets, sans qu’aucun d’entre eux ne soit garanti de s’imposer grâce à sa force ou son
intelligence.
Quel rapport avec les pays arabes et la sphère non occidentale plus généralement, me dira
t-on ?
Comme nous l’avons vu, il est possible de parler d’un passage de la médiation externe à la
médiation interne. Peut-être voit-on mieux où je veux en venir. La décolonisation, bien évidemment, est un cas de figure de ce passage. De fait, le colon n’est plus un être inaccessible. Il fait
partie désormais du même monde, ce qui est souhaitable, bien entendu, mais aussi propice au déchaînement de l’envie, des rivalités, de toute sorte de phénomènes d’émulation pour la possession
d’objets qui constituaient autrefois des rêves impossibles.
Mais les mécanismes mimétiques vont plus loin ; paradoxalement, comme dans un rapport
interpersonnel où chacun veut faire preuve d’indépendance, veut prouver à l’autre qu’il est autonome, le fait même de refuser notre enracinement mimétique, de prétendre à cette autonomie,
augmente la violence, et donc l’indifférenciation – que ce soit au niveau interindividuel ou au niveau inter étatique. On peut parler de convergences homogénéisantes ; le désir mimétique se
transforme en rivalités où, vu de l’intérieur du processus, chacun croit se singulariser. Mais un observateur extérieur ne peut que constater que cette volonté de se singulariser par des
surenchérissements culturels, religieux, politiques, commerciaux, etc. génère une violence exponentielle et contagieuse qui amène de fait les protagonistes à se ressembler de plus en plus. R.
Girard parle de « violence des doubles », qui ne pourra trouver sa résolution que dans le mécanisme de la victime émissaire – laquelle aura pour fonction de cristalliser toute cette
violence et de rétablir la paix.

III – LA RECOMPOSITION DE LIENS FRATERNELS
Cependant, là où monte le danger, croît aussi ce qui sauve, comme le dit Hôlderlin. La peur
peut être propice à une prise de conscience. Elle peut être bonne conseillère, comme l’avait montré Hans Jonas dans une problématique plus environnementale, ou encore Levinas dans la question du
rapport à l’Autre. De même, dans le processus d’addiction aux drogues, à l’alcool, etc., quoi qu’il en soit, la peur est bien souvent source d’un revirement, au principe de la conversion soudaine
ou progressive vers la sobriété.
Par ailleurs, pour ce qui concerne nos sociétés individualistes modernes, Ehrenberg montre
bien qu’on assiste à un tournant personnel de cet individualisme ; ce qui fait que les sentiments, affects, la personnalité enfin de chaque individu est devenue centrale. Et cela dans la
mesure où l’individualisme a ceci pour lui qu’idéalement il accorde une même valeur à chacun. Dès lors, ce point de vue permet aussi de reconsidérer la notion d’autonomie. L’individu est certes
responsable de lui-même dans l’individualisme, mais on peut distinguer aujourd’hui la « responsabilité abandon » où tout le monde se débrouille, et la « responsabilité
participation ». De cette dernière notion ont émergé les celles « d’empowerment », de « capabilité » (Amartya Sen), etc. Il s’agit alors d’encourager les capacités de
chacun, de permettre à ceux qui subissent les inégalités de saisir des opportunités en faisant en sorte qu’ils disposent d’un minimum de « biens premiers ».
Mais disons que tout cela reste assez alternatif pour le moment, même si ces idées
irriguent la philosophie des centres de soins, par exemple.

A – les fraternités.
Je reviens un moment sur le livre d’Isabelle Sorrente. Pour elle, c’est bien la raison qu’il s’agit de
recouvrer – mais une raison régénérée par la compassion -, une fois que l’on a touché le fond et admis notre impuissance face à cette dépendance.
Cette idée de reconnaissance de notre impuissance et d’abdication constitue une référence
au programme des groupes de conversion (AA, NA, etc.). Le salut, s’il est possible, ne peut en effet intervenir que sur le fond d’une reconnaissance de notre addiction, de notre incapacité à
maîtriser le calcul, la compulsion. « La » solution – comme pour les autres substances – ne passe pas par la volonté, ni par la révolte ou la dénonciation stérile, mais au contraire par
cette paradoxale reddition initiale qui participe d'une "décongélation" des sentiments humains. C’est à partir de là en effet que se met en place la conversion vers une vie plus
authentique, plus solidaire, plus fraternelle, au-delà de l’ego, dans laquelle il est possible d’échapper à la violence
mimétique.
Ce n’est sans doute pas par hasard si les groupes fonctionnent bien en pays d’Islam, et, en
Europe, chez les populations d’origine arabe. D’une certaine façon, les groupes fraternels viennent en effet se substituer au lien solidaire traditionnel perdu. Certes, ce lien ne s’articule plus
sur une verticale, celle de la pyramide des relations hiérarchiques ; il le fait selon une horizontale caractérisée par la réversibilité des relations entre égaux. L’axe fraternel se
substitue en quelque sorte à l’axe paternel. Mais, différence essentielle, il le fait selon des modalités toujours plurielles et locales. On peut en effet parler de petits groupes fraternels qui
s’organisent autour d’une problématique particulière. Ce pluralisme fait toute la différence : les fraternités pallient localement, mais concrètement, le lien hiérarchique de la structure
holistique.
Dans ce système du don – contre don tel que le décrivent Mauss ou Malinovski, il ne s’agit
évidemment pas d’accumuler des choses, mais de créer des liens solidaires sous forme d’amitié, de dettes et d’obligation. Peut-être est-il possible de revivifier la théorie du don, de faire en
sorte qu’il ne s’agisse pas seulement d’une survivance. Elle peut sans doute fournir un paradigme pour penser une société plus juste et plus humaine
dans laquelle la rentabilité économique n’est pas le critère unique. Dès lors, il s’agirait d’en régénérer l’esprit pour en faire le socle d’une société plus solidaire. Dans un monde où nous
sommes cernés par la menace d’objectivation, où tout devient valeur marchande, l’esprit du don, de par la relation qu’il institue entre les hommes, nous confirme que nous ne sommes pas des
choses. Sa logique permet de redonner du sens à notre vie sociale et contient potentiellement des promesses d’une autre société possible - laquelle passe en premier lieu par la construction d’un
nouvel imaginaire social.

B - Transmission de l’art versus consommation culturelle
J’ajouterais que, même si c’est insuffisant, le travail d’explicitation ou d’objectivation
des mécanismes addictifs, est aussi en lui-même au principe du processus de désaliénation susceptible de nous ramener à une raison pétrie, ou pénétrée, d’humanité.
A cet égard, dans le cadre des problématiques d’addiction, et plus précisément en post cure
où il s’agit de reconstruction sociale, psychologique, éducative, culturelle, voire spirituelle, il apparaît que, sous certaines conditions, des ateliers philosophiques et d’histoire de l’art ont
une pertinence socio thérapeutique peu contestable. Et cela au sens où c’est en fait l’idée de régénération des humanités dont il est question ici, et que nous nous efforçons de mettre en œuvre
modestement à ce niveau et à cette échelle très localisés. Ce type d’activités n’a pas une vocation occupationnelle en effet, ni de « promotion culturelle ». L’idée
« d’humanités » a une autre ambition puisqu’il s’agit d’aider les participants à retrouver des formes de sensibilité, un rapport à la réalité médiatisé par certains sentiments humains –
lesquels étaient sclérosés au cours de l'addiction. Ces ateliers, comme d'autres techniques, contribuent, nous le souhaitons, à une "décongélation" de la sensibilité, des sentiments et émotions
constituant notre humanité.
Plus loin, ils visent à faire percevoir que l’écrivain, le peintre le philosophe qui nous
décrivent un trait culturel singulier ne nous parlent pas d’autre chose, paradoxalement, que de ce qui constitue notre commune humanité et que nous pouvons mettre à jour par l'intermédiaire de
leur œuvre ; idéalement, leurs œuvres nous donnent des clefs qui nous permettent de nous approfondir, de découvrir de nouvelles régions de nous-mêmes, de l’autre et du monde, ainsi que de
nouveaux horizons de sens. Il faut ainsi faire le pari qu’embellir et approfondir par la médiation culturelle les liens qui rattachent à des racines singulières est une façon de nous mettre aussi
en lien avec le reste de l’humanité.
Dans la mesure où l’artiste nous permet de percevoir des aspects de nous-mêmes, du monde,
du rapport à l’autre, qui ne sont pas nécessairement régis par l’utilité, la transmission de l’art s’oppose ainsi à la promotion culturelle de l’industrie du même nom qui standardise les désirs.
L’art en effet nous permet d’avoir accès à des régions de l’être qui ne sont pas pris dans le réseau des échanges commerciaux. En ce sens il est émancipateur et peut être vecteur de résistance,
selon des modalités qui sont toujours à inventer.
Actualiser ce qui resterait à l’état de potentiel chez chacun d’entre nous sans ces
médiations, comprendre la profondeur d’un sentiment qui nous anime et pouvoir l’inscrire dans une histoire, percevoir une peinture avec un regard régénéré qui décèle en elle des virtualités
inconnues, être touché par un texte classique qui semble nous parler personnellement : nous constatons concrètement que tout cela tend à générer un regain d’estime de soi, source de bien d’autres
possibles - les lecteurs ou spectateurs se percevant dès lors comme les dépositaires d’une culture universelle.

CONCLUSION
Nous l’avons vu, l’addiction est un phénomène à la fois général et insidieux, qui dépasse
largement le domaine des produits modifiant le comportement, d’une part, et sans doute aujourd’hui la sphère occidentale, d’autre part. A ce niveau de généralité, c'est d'un véritable processus
global de déréalisation dont il est question, une déconnection quasi planétaire avec la réalité, la production d'une (ou plusieurs) hyper réalité inhérente à un rapport purement quantitatif à
l'environnement et à notre rapport à nous-mêmes et à l'autre.
En réchapper suppose que nous retrouvions la raison, ce qui permettrait de mettre fin à la
sclérose, la congélation de notre sensibilité, de sentiments tels que la compassion pour notre entourage. Processus circulaire sans doute, qui
réclame à la fois une vigilance, une conscience, mais aussi le courage d’affronter ce que l’on peut appeler le devenir sujet d’un individu.
Au-delà de ce postulat général, la reconnaissance de notre dépendance - prémisse d’un
processus d’émancipation -, l’approfondissement de nos racines culturelles - vecteur de notre commune humanisation -, la constitution de groupes fraternels, de communautés inavouables - source de
solidarité toujours locale -, apparaissent comme autant de conditions, mais aussi de supports susceptibles de nous fournir une aide sur ce chemin difficile, tout autant que riche et
passionnant.

/image%2F0669930%2F20220202%2Fob_de12fe_img-20220127-183309-531.jpg)



/image%2F0669930%2F20220202%2Fob_a246df_img-20220127-183309-531.jpg)